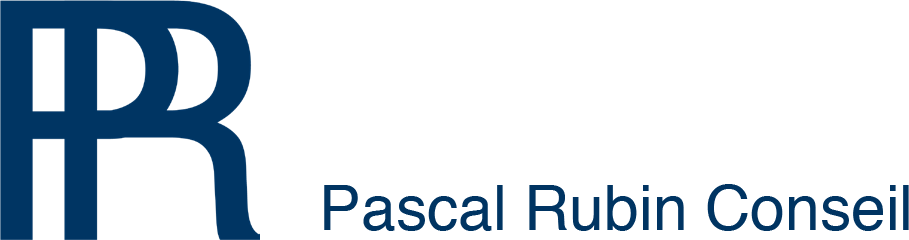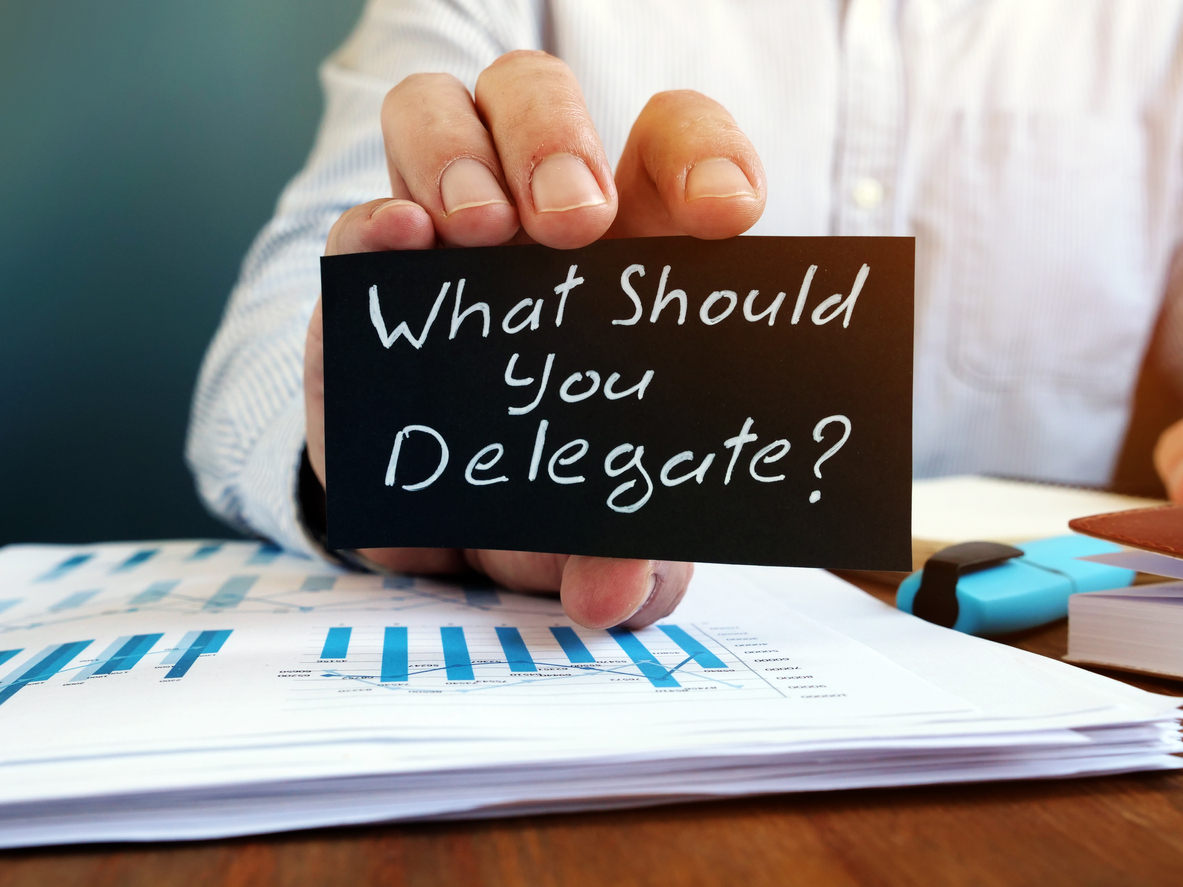
La délégation est indispensable dès lors qu’on dépasse un certain volume d’activité ou un certain nombre de personnes impliquées. Ce constat existe depuis des temps immémoriaux puisque même la Bible* en fait mention dans un passage où Moïse, pour faire connaître les ordonnances de Dieu, exerce la délégation sous tous ses aspects :
- La vision, la stratégie et la conduite d’un groupe de personnes appartiennent à l’entité qui délègue (la direction) ;
- Cette dernière doit instruire les délégués de leur mission et leur indiquer la voie à suivre, par exemple politique générale de l’entité ou contrat d’objectifs avec les unités subordonnées. Elle doit ensuite se garder d’intervenir dans les matières concernées sauf si elle est saisie par un délégué d’une affaire grave ;
- Les délégués agissent à la place du déléguant comme si c’était lui qui agissait. Ils allègent ainsi sa charge mais en même temps, lui permettre de démultiplier sa capacité d’action, qui devient alors plus forte et plus efficace.
La subsidiarité
Le rôle des cadres ou des dirigeants n’est pas extensible à l’infini. Et chaque fois qu’ils font quelque chose qui ne relève pas de leur mission, c’est au détriment de celle-ci : anticiper, planifier, donner du sens, organiser, faire faire et non réaliser directement. La responsabilité d’une action, lorsqu’elle est nécessaire, doit être confiée à la plus petite entité capable de résoudre le problème d’elle-même. Il s’agit de ne pas faire à un niveau plus élevé ce qui peut l’être plus efficacement à une échelle plus faible (l’engagement d’une infirmière dans un service de soins intensifs ne devrait pas concerner la direction !)
On doit alors trouver quel peut être le niveau d’action le plus efficace : le service est parfois trop petit, l’établissement souvent trop grand. La bonne taille pourrait être le département ou le pôle qui présente la dimension idéale pour disposer à la fois d’une gestion de proximité et d’une mutualisation de moyens dans une grand établissement (plus de 200 millions de francs de CA).
Le management
Le management représente la capacité des dirigeants à motiver les collaborateurs dans leur travail. Cette motivation ne peut exister sans appropriation de ce travail, non seulement dans ses modalités mais surtout dans ses objectifs. C’est en faisant partie intégrante d’un projet global qu’ils connaissent et comprennent, qu’ils sont reconnus par la direction comme des acteurs majeurs du projet, que l’ensemble des collaborateurs d’une institution de santé, médecins ou non, ont une motivation au travail.
Cette motivation requiert de partager les objectifs (le « pourquoi ») mais aussi de préserver de l’autonomie dans les aspects touchant à la réalisation (le « comment »). Il n’est pas rare que la direction ne communique pas suffisamment sur le projet avec les collaborateurs et se contente de définir le « comment » de façon bureaucratique.
Les établissements qui parviennent à définir clairement le « pourquoi », tout en laissant ensuite une grande liberté d’appréciation et d’organisation aux acteurs sur le terrain, le « comment », sont ceux qui ont souvent la meilleure qualité de service, la plus grande satisfaction des patients, les meilleurs résultats financiers et donc l’assurance d’une pérennité.
Citons l’exemple du CHU de Dinant en Belgique. C’est dans la crise financière que Patrick de Coster, médecin et directeur de ce CHU décide de modifier radicalement le style de management de son établissement. Il comprend que dans les années futures, son hôpital devra travailler avec des moyens réduits et qu’il est illusoire d’espérer « un grand soir » de la dotation budgétaire. Par ailleurs il sait qu’il ne peut demander au personnel de fournir des efforts supplémentaires. Il est convaincu qu’il fait déjà le maximum au vu du système existant et prend donc la décision de modifier radicalement sa manière de gérer. S’inspirant de la méthode Lean qui a fait ses preuves dans le milieu industriel, il prend l’option d’inverser la pyramide, mettant en priorité non plus sa direction générale mais le personnel de terrain en contact avec le patient. Pour cela, il leur donne le pouvoir de décider quelle organisation ils veulent mettre en place pour réduire les pertes de temps et les inefficiences qui rendent la vie quotidienne difficile. La direction se place donc au service des opérateurs de terrain pour les aider à réaliser leurs objectifs de satisfaction du patient, au lieu de passer son temps à les contrecarrer. Après quelques années, les progrès sont tangibles en termes de qualité pour les patients, de qualité de vie pour les soignants et de résultats financiers pour l’établissement.
______